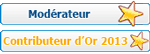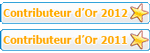En d’autres termes et du point de vue du photographe :
Ce n’est pas directement le nitrate d’argent qui noircit, mais, de nos jours, le bromure d’argent ou un mélange de bromure et de chlorure d’argent. A l’aube de la photographie, il existait des techniques utilisant le chlorure d’argent seul ou un mélange de chlorure et de citrate d’argent (papier citrate) ou encore un mélange de chlorure, bromure et iodure d’argent. Le problème étant que tous ces sels d’argent sont insolubles ou très peu solubles et doivent donc être formés in-situ à la surface du papier ou dans une émulsion de gélatine étendu sur le papier (papier au gélatino-bromure d’argent).
Pratiquement, voici un mode opératoire pour le papier « salé » (c’est très simple, et il fut utilisé, avec de multiples variantes, tout au long du XIXe s. jusqu’à l’utilisation quasi-universelle des papiers à émulsion).
1/ Imprégner un papier de bonne qualité d’une solution de chlorure de sodium ou d’ammonium (à environ 2%) puis le faire sécher, il se conserve ainsi indéfiniment.
2/ Imprégner ce papier « salé » d’une solution de nitrate d’argent (à environ 10%) sur un seul côté, la solution ne doit pas passer au dos de la feuille. Il se forme alors du chlorure d’argent selon : NaCl+AgNO3=AgCl(s)+NaNO3 (NaNO3 ne joue pas de rôle dans la formation de l’image et est éliminé dans les bains de rinçage ultérieurs). La surface du papier contient donc maintenant du chlorure d’argent et un excès de nitrate d’argent qui joue un rôle important par la suite. Le papier est alors photosensible, doit être sécher dans l’obscurité et utilisé le plus rapidement possible.
3/ Exposition aux UV sous un négatif ou tout autre obstacle (photogrammes). Là il y a deux options :
A/ Papiers à noircissement direct : comme le disent les photographes du XIXe s. « c’est la lumière seule qui forme le dessin », les UV réduisent le chlorure d’argent en argent métallique « colloïdal » et donc du chlore se libère et se combine à nouveau avec le nitrate d’argent en excès pour former du chlorure d’argent lui-même réduit etc…Pour une image de bonne densité, le processus est assez long (environ 15 à 30 minutes en été), l’image est généralement de couleur jaune-sépia, ceci est du à la taille des amas d’argent métallique (plus ils sont fins plus l’image tend vers la jaune). Ensuite, l’image est rincée pour éliminer le nitrate en excès puis fixée dans une solution de thiosulfate de sodium (hyposulfite de sodium) pour dissoudre le chlorure d’argent non insolé. Il n’y a pas de développement.
B/ Papiers à développement (c’est ce que nous utilisons exclusivement aujourd’hui) : le papier est exposé et il se forme une image latente (invisible), celle-ci est ensuite développée par divers réducteurs des halosels d’argent. Le premier réducteur utilisé historiquement fût l’acide gallique en solution saturée (9g/l environ), puis différent réducteurs de la famille des phénols ou des amines. Pour plus d’information sur le sujet je te recommande ce site :
http://nicephore.menard.free.fr/autres.php?id=85
Il y a un article en trois parties très complet sur les constituants d’un révélateur.
Autre précision, les papiers à noircissement direct ne sont sensibles qu’aux UV et l’impression ne se fait que par contact (pas d’agrandissement), les papiers à développement modernes ont une émulsion de gélatino-bromure d’argent beaucoup plus sensible (par maturation de l’émulsion) et permettent des tirages par projection.
Il faut aussi prendre en compte que dans un cas comme dans l’autre seulement 5 à 10% des sels d’argent utilisés forment réellement l’image finale, à méditer question récupération.